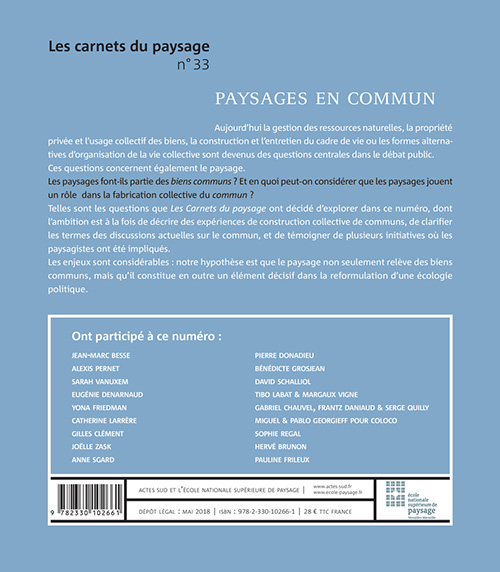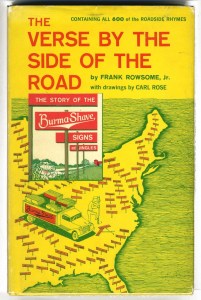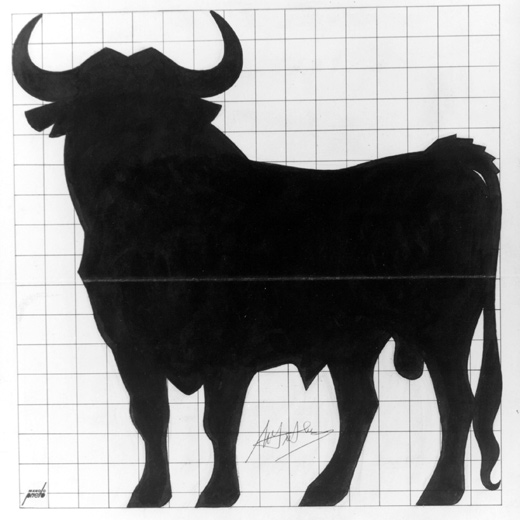Toutes les citations en italiques sont extraites d’échanges par mails, de janvier à mars 2016. Fabrice Ney m’avait contacté via Démarches durant une période qu’il consacrait au classement et à la réactualisation de son œuvre photographique. [NDRL]
Démarches rend hommage à Fabrice Ney, photographe auteur décédé le 25 février 2025 à Marseille.
Sa carrière de photographe commence après des études en sciences économiques, avec un intérêt poussé pour les aspects sociaux, historiques et philosophiques.
Il commence par exercer divers métiers, « j’ai occupé dans l’industrie métallurgique, les postes de responsable qualité, de responsable de la prévention des risques professionnels et de responsable de l’ingénierie pédagogique », avant de se consacrer à une pratique photographique exigeante de lieux et de territoires, dont il sera un mémorialiste passionné.
Il décompose son expérience ainsi :
« Professionnelle : de la pratique régulière d’une activité qui permet de délimiter un champ d’expertise socialement signifiant
Scientifique : d’une mise en situation permettant de tester la validité et les limites d’une hypothèse, d’une proposition, (l’expérimentation désigne les modalités de mise en œuvre de cette expérience)
Vécue : de la confrontation à quelque chose qui advient et qui provoque chez celui qui en est l’objet, le besoin une réappropriation réflexive en tant que sujet »
Dès 1978, il capture des espaces urbains, industriels, agricoles et naturels, créant un catalogue photographique riche et varié. Son œuvre se distingue par une approche systématique et analytique des paysages et des environnements qu’il photographie.

Il interroge le vocabulaire :
« J’ai, par exemple, une difficulté concernant l’usage, selon moi abusif, du mot territoire. Ce qui est parfois ainsi désigné, me semble caractériser plutôt le lieu.
De même, avec le simple mot de « marche ». J’éprouve des réticences au concept déployé par certains de photographes-marcheurs : car ce que beaucoup entendent par-là, les relie au paysage comme point de vue.
Je pense que les notions de paysage et de territoire sont intimement liées: ils ont trait aux principes organisateurs de nos environnements. Pour moi la notion de lieu, nous plonge directement dans l’expression de l’intersubjectivité des acteurs (d’où le lien entre lieu et mode de découverte par la marche comme promenade ou flânerie). Ce qui ne peut être le cas avec le territoire que nous le considérions comme domestique (distribution des rôles familiaux et organisation de l’habitat) ou plus large au niveau de ses aménagements, de la maitrise des flux et des affectations fonctionnelles. »
Il précise sa conception du parcours et du déplacement :
« L’assemblage d’images, comme expression des déplacements physiques reste à mon sens valide, mais cette proposition doit être analysée comme inhérente à l’acte photographique. Effectivement, ce qui nous intéresse ce n’est pas ce déplacement mais son résultat, la vision morcelée-recomposée, je pourrais l’aborder une autre fois avec la question du témoin et de la mémoire. De même la fluidité des parcours dans un espace donné, par exemple dans ZUP n°1, est importante à noter dans la constitution du corpus, car elle participe de son unité. Mais ici encore, elle sert à marquer la position du témoin et résulte de ma décision sur la qualité de déplacement dans l’espace, et de ma posture photographique en tant qu’auteur. »
Ney a participé à de nombreuses expositions collectives et personnelles, mettant en lumière des sujets tels que les portes de HLM, les paysages de la région de Marseille, et les mémoires industrielles. Son site exhaustif sur ses travaux témoigne de ses recherches et des procédures mises en œuvre pour chaque projet. Avec des exigences intellectuelles fondées sur une culture politique acquise durant sa formation, il documente la mémoire industrielle de sa région, mettant l’accent sur les conséquences humaines des impacts environnementaux.

ZUP n°1, 68 portes, 1981-1983
Au sujet de la présence/absence humaine, il précisait
« Cette pratique se définit par l’observation d’espaces marqués par la présence humaine, dans la mesure d’un questionnement sur ce qui peut être évoqué de cette présence au regard des images réalisées en l’absence de personnages. Ce qui signifie clairement que la position de l’observateur (témoin) est une problématique qui fait partie des constantes relevées plus haut. Cette position possède nécessairement une dimension physique, mais elle résulte de choix éthiques, esthétiques et politiques et si cette position peut être mise éventuellement en jeu dans la représentation, ce n’est que comme image de ces choix. »
Il y présente une chronologie détaillée de ses principaux travaux et expositions, offrant un aperçu de son parcours artistique et de ses contributions au monde de la photographie. Il a également collaboré avec des chercheurs et des institutions pour illustrer des études sociologiques et des thèses, apportant une dimension visuelle aux travaux académiques.
Fabrice Ney a exploré et documenté les transformations des territoires, offrant un regard unique et sensible sur les lieux qu’il enregistre. Il réfléchit à l’expérience du regard, du [regard… sans personne]
« Un regard… sans personne » vise certes l’expérience, au sens le plus communément partagé, du sentiment d’abandon, de vide, de déréliction, de perte, celle de l’étrangeté. (Il y a bien sûr une référence à Heidegger et aux auteurs ou courants de pensées « monumentaux » du XXème siècle, mais je ne suis pas philosophe, je ne suis pas psychanalyste (non plus!). Je vis simplement dans mon Temps et ce Temps traverse mon regard.) Mon propos est de considérer cela comme une expérience simple, commune, immédiate, directe, qui ne peut être partagée que dans la mesure de la qualité de son expression. Car si l’expérience est commune, son occurrence est toujours singulière et son partage nécessite la pudeur d’une évocation. Ce qui ne l’empêche pas d’être obscène en soi, mais son expression condamne toute obscénité. Or le regard est un lieu privilégié de cette expérience. Il renvoie sans cesse l’individu à son existence sociale, dans l’interprétation permanente des signes qui ne cessent de le solliciter, mais il le confronte aussi à une vision en brèche à la limite de l’intelligible.
Ainsi, la photographie est pour moi, d’abord une expérience singulière du monde, celle d’une frontalité. Il ne s’agit pas là d’un type de cadrage. Quel que soit l’angle de prise de vue, photographier est toujours se mettre en position de frontalité dans le monde (et pas forcément face aux choses qui le composent). Maintenir ce point de vue est effectivement une affaire de cadrage, mais surtout de maintien d’une tension dans le cadre. La conscience de la saturation du négatif, de sa surface, exclut, au résultat, le sujet qui photographie, alors qu’elle devrait en être l’expression.
(C’est pour cela que je ne revendique pas la frontalité – en tant que technique de cadrage – comme mode unique de prise de vue. Même si il peut être privilégié. Mais je revendique la relation frontale au monde à laquelle nous expose l’expérience photographique.)
C’est moins l’absence qu’il s’agit de représenter que son sentiment paradoxal : tenter de partager le sentiment que nous sommes absents à nous-même et que c’est la seule chose qui nous relie dans la communauté de nos regards singuliers.
(L’absence de personnage, au-delà de la proposition méthodique de départ, n’exclut pas la possibilité de représenter ponctuellement une présence comme stylisation ultime de l’absence.)
Mes images s‘adressent à cette communauté. Cette adresse est constitutive d’une attention soutenue du regard sur ce que nous vivons… nous tous.
Ainsi l’image est un lieu où transite le regard qui se risque à la vision de ce qu’il n’est pas, un point précis qu’il n’a de cesse de combler. »
La référence à Heidegger renvoie au concept de « jetéité » (Geworfenheit), élément central dans son ouvrage « Être et Temps » (Sein und Zeit). Il fait référence à l’idée que les êtres humains sont « jetés » dans le monde sans avoir choisi de naître ni les conditions dans lesquelles ils naissent.
En d’autres termes, nous nous retrouvons déjà immergés dans une réalité avec des circonstances, une histoire, une culture et des relations préexistantes. Cette « jetéité » souligne notre manque de contrôle initial sur notre existence et notre situation.
La « Geworfenheit » est donc une condition de fait de notre être, qui nous pousse à nous engager activement dans la vie et à affronter la réalité de notre situation pour trouver notre propre voie et sens.
Laissons à Fabrice Ney le soin de conclure
[Le photographe ne doit-il pas se perdre dans l’acte d’affleurement de cette expérience étrange et commune d’être au monde.
Et, de cette expérience partagée, disparaître de la surface de l’image pour laisser la place à l’insistance d’un regard – sans personne.
Ainsi, considérons l’auteur : une fiction spectacularisée de soi.]
mai 2015
Avertissement concernant les droits d’auteur :
Un regard sans personne :est une marque déposée auprès de l’INPI (n°4365340 en classe 40 41 42)
Hommage :
Annonce de André Mérian
En mémoire de Fabrice Ney, photographe, artiste, auteur et ami, le Centre Photographique Marseille organise un temps d’hommage les 09 et 10 mai prochains.
Le vendredi 9 mai à partir de 18h, installation photographique, débats et discussions avec les interventions de : Emmanuelle Ancona et Christophe Asso qui parleront de leur collaboration pour le livre SOUDE ; André Forestier, François Landriot, Suzanne Hetzel, André Mérian et Franck Pourcel retraceront l’histoire de l’association SITe ; Jordi Ballesta évoquera sa relation à la recherche et à l’art contemporain, notamment autour des livres Photographier le Chantier et Zup N°1.
Le samedi 10 mai à 14h : table ronde à plusieurs voix autour de la notion de transmission (relation aux jeunes public et soutien aux jeunes artistes), de son usage des archives et des questions de scénographie et de mise au mur.
Hommage à Fabrice Ney
Vendredi 09 Mai à 18h00/Samedi 10 à 14h
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

IMPORTANT :
En consultant les sites suivants vous accèderez à son site officiel, mais aussi à deux entretiens complémentaires pour découvrir la genèse de son travail:
- site officiel
https://www.fabriceney.com/ - Propos recueillis par Christophe Asso pour Photorama Marseille février 2022
https://photorama-marseille.com/fabrice-ney-le-territoire-en-mouvement/ - Interview à l’occasion de la sortie de l’ouvrage ZUP n°1.
https://www.biblio13.fr/biblio13/home/nos-bibliotheques/archives-echange-avec-un-artiste/area_bot/area_bot/fabrice-ney.html